
Grandes écoles : le blues des cracks
Dans quelques semaines, des milliers d’étudiants vont débuter leur scolarité au sein d’une grande école. Qu’elle soit de commerce ou d’ingénieur, elle représente aujourd’hui un passeport sécurisé vers l’emploi. Et la voie royale pour y accéder reste le passage par deux ou trois ans de classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE), particulièrement si l’on vise les meilleures, en tête desquelles on trouve le prestigieux binôme, HEC et l’École polytechnique.
Mais pour les élèves de «prépa», l’arrivée en grande école n’est pas toujours aisée. Rythme de travail, encadrement, environnement: tout change de manière radicale. Pour des élèves habitués à être stimulés et choyés par des professeurs omniprésents, la découverte de l’autonomie peut être déstabilisante, voire déprimante. «L’intégration d’une école de commerce après la prépa suscite beaucoup d’excitation durant l’été, mais au bout d’un mois ou deux on commence à se lasser des cours trop ennuyeux. On sent que nos capacités acquises en prépa s’amenuisent…», reconnaît Clara, qui a rapidement «commencé à avoir des coups de blues». Il y a «un énorme fossé entre la prépa et l’école», précise Karelle, qui a intégré Télécom École de management après deux années de CPGE. Elle mentionne un «rythme de travail totalement différent» qui permet de «sortir en semaine, c’est dire!» et des cours «où l’on s’ennuie parfois, surtout en amphi».
«Désœuvrés»
Nicolas*, lui, mâche moins ses mots. Après deux ans de prépa, il décide de «khûber», soit de faire une troisième année pour tenter d’obtenir de meilleurs résultats aux concours, et obtient une place à HEC. Très fier, il l’a «ressenti comme la plus grande réussite de [sa] vie». Mais très vite, il déchante. Il déplore «un manque total d’intérêt pour des cours superficiels et un emploi du temps très léger» qui laisse les étudiants «désœuvrés». Suleiman, étudiant sur le campus bordelais de Kedge Business School, nuance en parlant de «cours complètement différents», et de la difficulté de s’adapter à la logique du travail en groupe après deux années de concurrence exacerbée entre étudiants. Autre facteur potentiellement aggravant, l’implantation de certains campus loin des centres-villes. «Le fait que le campus d’HEC soit à Jouy-en-Josas (au sud de Versailles à 45 minutes du centre de Paris, NDLR), et qu’il soit impossible d’en sortir pour ceux qui n’ont pas de voiture est vite pénible», regrette Nicolas.
«Le blues des prépas a toujours existé, relativise Martine Mordant, directrice générale adjointe de Kedge Business School, pas inquiétée outre mesure. Ces jeunes, qui sont de très bons élèves, ont passé deux ans avec une pression et une charge de travail conséquentes tout en étant dans l’incertitude sur les résultats. En arrivant en école, d’un coup, ils sont plus libres et font face à de nombreuses opportunités». «Ils passent d’un monde très structuré à un monde fait d’inconnu, de tests et d’approximations. L’apprentissage se fait de manière différente et pour eux, cela peut être un changement brutal», confirme Bernard Belletante, directeur général de l’École de management de Lyon (EM Lyon).
Pour éviter le coup de blues, voire la dépression, les écoles misent sur les premières semaines pour «transformer» leurs étudiants
Pour éviter le coup de blues, voire la dépression, les écoles misent sur les premières semaines pour «transformer» leurs étudiants. À l’Edhec, ils débutent leur scolarité par le «Coop Tour»: par groupes de 12, ils doivent réaliser une vidéo de 25 secondes sur un thème donné. Une manière de les habituer au travail en groupe et de les familiariser avec le «système grande école». À l’École polytechnique, qui jouit d’un statut particulier d’école militaire, la rupture est plus brutale encore. Les étudiants débutent leur scolarité par une formation militaire d’un mois, dont trois semaines se déroulent au camp de La Courtine (Creuse). Puis, ils enchaînent par un stage de six mois: 60 % des étudiants iront en stage militaire, et le reste dans le civil, la plupart dans des organisations humanitaires. Une entrée en matière qui «leur apprend à travailler en section, avec de nombreux exercices collectifs qui rompent avec l’accomplissement individuel recherché en prépa, explique Frank Pacard, directeur de l’enseignement à l’X. Ces étudiants «souvent immatures» à la sortie de la prépa ne sont «pas préparés» au stage qui suit. «Cela les aide à grandir et à sortir du système de bachotage: ils entrent dans le concret». L’EM Lyon fait aussi le pari de la semaine d’intégration au côté d’anciens étudiants et de professeurs.
Surtout, les grandes écoles comme leurs étudiants misent sur la vie associative. Nicolas admet que «le temps libre nous est laissé pour qu’on puisse faire des choses constructives». «J’ai diversifié mes activités, donné des cours, fait plus de sport et participé à des associations», raconte l’étudiant d’HEC. Clara, Karelle ou Suleiman font tous partie d’une association qui leur demande un investissement conséquent, et profitent des joies des fêtes étudiantes nombreuses en école. Après un an de scolarité, tous disent avoir oublié leur déprime et apprécient leur nouvelle vie autonome, loin de la rigueur de la classe préparatoire.
* Le prénom a été changé.
Interview
Xavier Pommereau est psychiatre, chef du Pôle aquitain de l’adolescent au CHU de Bordeaux et auteur du «Goût du risque à l’adolescence» (Albin Michel).
LE FIGARO. - Comment expliquez-vous que les étudiants issus de classes préparatoires soient touchés par ces périodes de déprime?
Xavier POMMEREAU. - C’est une population particulière. La majorité de ces jeunes gens sont bien formés intellectuellement et issus de milieux favorisés, donc on pourrait se dire que ce sont des jeunes sans problèmes. Ce n’est pas la réalité: ils sont très sensibles au stress et ses conséquences, associés à un culte de la performance développé en classe préparatoire. Le problème, c’est que leur comportement ne change pas quand ils entrent en école, où ils se trouvent confrontés à une formation qui ressemble à un magasin de grande surface. On met à leur disposition des paquets gigantesques de connaissances mais rien qui fasse l’unité, et peu d’encadrement. Souvent, ils se retrouvent perdus dans la masse d’informations.
Quels problèmes de santé récurrents observez-vous dans votre centre, chez les étudiants issus des classes préparatoires?
Ils viennent chez nous lorsqu’ils ressentent un sentiment d’épuisement. Ils commencent à réellement s’inquiéter lorsqu’ils ont le sentiment de ne plus pouvoir travailler, car chez eux, tout est centré sur la réussite des études. Ils présentent souvent des signes de déprime, ils ont des gros problèmes de sommeil mais également des symptômes d’addictions, particulièrement à l’alcool. Ces étudiants font beaucoup la fête pour ne pas se sentir isolés. C’est une sorte de marquage, un rite d’intégration dans les grandes écoles. Pour bien faire, il faut avoir une pinte à la main, cela fait partie de la reconnaissance au sein de ces groupes. Chez les jeunes femmes, il est fréquent de voir également des troubles alimentaires, avec des crises d’anorexie ou de boulimie.
«Issus de milieux favorisés, on pourrait se dire que ce sont des jeunes sans problèmes»
Xavier Pommereau, psychiatre
Comment les grandes écoles peuvent-elles lutter contre cette déprime et ses conséquences?
Il faut qu’elles prennent conscience de ces réalités, qu’elles soutiennent des programmes à l’intérieur de l’établissement qui privilégient la prise de responsabilité, l’encadrement par des pairs. Les grandes écoles disent favoriser le sport et la vie associative, mais il faudrait que des adultes soient impliqués auprès des étudiants. Il existe encore un décalage entre les représentations que les adultes ont des jeunes et la capacité de réflexion de cette jeunesse qui n’est pas preneuse de slogans mais d’échanges et de discussions.
Des cellules de soutien psychologique voient le jour
Les grandes écoles se munissent de structures pour encadrer leurs étudiants, et prévenir les comportements à risque.
«Nous ne sommes plus seulement des pourvoyeurs de connaissances, mais nous devons veiller au développement personnel de nos étudiants», énonce Bernard Belletante, directeur de l’EM Lyon, où toute une équipe a été mise en place «pour repérer les addictions, le surmenage et le stress, mais aussi la solitude, la déprime ou la dépression». Une sorte de «centre de bien-être» y a été créé, sur le modèle de ce qui existe déjà sur les trois campus de Kedge BS, à Marseille, Bordeaux et Toulon. Ces dispositifs «Wellness» servent à gérer «coup de blues, déprime, situation “galère”, isolement…». «Le Wellness Center est un point d’entrée pour l’étudiant qui a besoin d’exprimer une difficulté, explique Martine Mordant, directrice générale adjointe de l’école. Nous avons un responsable et un psychologue sur chacun de nos campus, épaulés par un réseau de bénévoles.» Sur l’année 2015-2016, 347 étudiants de l’école ont contacté l’équipe de soutien. «Ce chiffre est à rapprocher de l’effectif étudiant global du groupe, autour de 11 000 étudiants. C’est à la fois significatif mais faible en proportion, avec moins de 5 % de la population», analyse Martine Mordant. Les principaux motifs de consultation, sur deux des trois campus de l’école, sont des demandes de rencontre directe avec un(e) psychologue. À Bordeaux, l’année dernière, 58 % des étudiants pris en charge par le Wellness Center étaient des «nouveaux entrants».
(Source Le Figaro)
Catégories
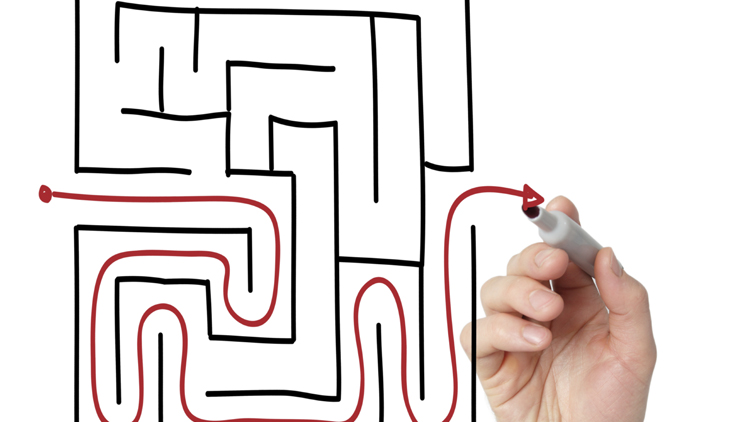
Administration




