
Comment le viol est devenu un rituel dans les fraternités étudiantes (américaines)
Une fille sur cinq est victime d’agression sexuelle sur les campus américains titrait The Guardian à la rentrée 2014. Un chiffre alarmant qu’il faut additionner à un autre, tout aussi inquiétant : les garçons, membres d’une fraternité sont quatre fois plus amenés à commettre un viol que les autres. Et la récente affaire de Brock Tuner, cet étudiant de Stanford accusé d’avoir violé une jeune femme, vient remettre sur le tapis un problème très ancré au sein de ces fraternités estudiantines : la ritualisation du viol.
Durant des années – voire des décennies – elle avait voulu fermer les yeux. Cette bonne société américaine qui envoie ses enfants dans des universités friquées au gazon bien coupé et aux billards toujours astiqués. Des études pour lesquelles ces familles s’endettent pendant des années, voire plus. Mais une fois que leur charmante progéniture est enfermée entre quatre murs – à Stanford, Berkeley ou Harvard – ces parents ne savent plus rien de ce qu’elle fait… et ne veulent surtout rien en savoir. Ils étudient, passent leur journée à la bibliothèque et leur soirée dans leur chambre de 12m2, se rassurent-ils. Mais la réalité est toute autre. Loin du nid familial, ils font la fête, se droguent, boivent et… certains violent des étudiantes.
L’affaire « Brock Turner » – comme on l’appelle maintenant outre-Atlantique où l’on ne parle plus que de ça – qui a éclaté début juin 2016 a enfin bousculé cette néfaste hypocrisie. Un soir de janvier 2015, Brock Turner, 20 ans, étudiant bien sous tout rapport à Stanford et meilleur élément de l’équipe de natation de la fac qui lui prédit même un avenir olympique, fait les quatre cents coups à une fête organisée par une fraternité (Kappa Alpha). Au cours de la soirée, il repère une jeune fille enivrée, quasi inconsciente, qui était simplement venue rire un peu, danser, bref s’amuser, accompagnée de sa sœur. Il l’emmène derrière une benne à ordures et la viole. Ce sont deux Suédois, qui passaient à vélos, qui ont donné l’alerte. Car la jeune fille – les journalistes l’appellent « Emily Doe » puisqu’elle a voulu rester anonyme – ne se souvient de rien. Black-out total.
L’électrochoc
Mais pourquoi cette histoire remue autant les États-Unis ? Dans un pays où une tentative de viol est commise toutes les deux minutes et demi (selon les statistiques de Key Facts), cette affaire sordide aurait pu malheureusement tomber dans l’oubli. C’est tout d’abord la lettre de la victime adressée directement à son bourreau qui a bouleversé le pays, pourtant chahuté par une violence quotidienne.
« Tu ne me connais pas, mais tu as été à l’intérieur de moi, et c’est pour ça que nous sommes ici aujourd’hui. Le 17 janvier 2015, je passais un samedi soir tranquille à la maison. Mon père a fait à manger et je me suis attablée avec ma petite sœur qui était de passage pour le week-end. J’avais un boulot à temps plein et on s’approchait de mon heure de coucher. Je comptais rester chez moi, regarder la télé et lire, pendant qu’elle allait à une fête avec ses potes. Et puis j’ai décidé que c’était ma seule soirée avec elle, je n’avais rien de mieux à faire, alors pourquoi pas se bouger et aller à une fête à dix minutes de chez moi ? (...) La première chose dont je me souviens ensuite, c’est d’être sur un brancard dans un couloir. J’avais du sang séché et des pansements sur le dos de mes mains et mon épaule. J’ai pensé que j’étais peut-être tombée, que j’étais dans un bureau sur le campus. J’étais très calme, et je me demandais où était ma sœur. Un policier m’a expliqué que j’avais été agressée. Je suis restée calme, pensant qu’il parlait à quelqu’un d’autre. Je ne connaissais personne à cette fête. Quand on m’a enfin autorisée à utiliser les toilettes, j’ai baissé mon pantalon d’hôpital, voulu baisser ma culotte, et n’ai rien trouvé. Je me rappelle encore la sensation de mes mains touchant ma peau et n’attrapant rien. J’ai regardé, et il n’y avait rien. Le fin morceau de tissu, la seule chose entre mon vagin et le reste du monde avait disparu, et tout en moi s’est tu ».
Mais c’est surtout la sentence du procès – rendue le 4 juin 2016 – qui a provoqué le plus de réactions. Alors que Brock Turner encourait jusqu’à 14 ans de prison, il n’a finalement écopé que de six petit mois dont trois fermes. Pire encore, après seulement trois petits mois de détention, il sera libéré, le 2 septembre 2016, pour « bonne conduite » et ne sera pas fiché en tant que délinquant sexuel en Californie. Le père de l’accusé lui, ne manque pas d’arguments pour défendre son rejeton. Dans une lettre rendue publique par Michele Dauber, professeur de droit et sociologue en charge depuis plusieurs années de la modification du règlement intérieur de Stanford, il dit trouver la peine trop dure pour seulement « 20 petites minutes d’action ». Il explique même que l’inscription de son fils sur le registre des prédateurs sexuels « va limiter où il peut habiter ou travailler ». « Il n’est plus joyeux et n’a plus sourire. Il aimait certains plats, particulièrement les steaks, mais il n’a plus d’appétit », a-t-il précisé. Brock Turner, quant à lui, regrette cette « erreur » (non, non, il n’utilisera pas le mot « crime »). Et il jure, main sur la Bible, qu’il n’aura plus désormais le cœur à la fête et qu’il essaiera – oui, qu’il essaiera – de ne plus abuser de l’alcool. Des propos ahurissants qui soulignent un problème plus profond : la culture du viol omniprésente sur les campus américains et en particulier dans les fraternités.
La fraternité est un concept purement américain auquel on ne trouve pas vraiment d’équivalent français, si ce n’est les BDE (Bureau des étudiants) des grandes écoles et autres facs de médecine dans lesquels des « adulescents » organisent des jeudis-beuverie. Mais aux États-Unis, les fraternités sont bien plus que de simples associations puisque les frères – ou les sœurs quand il s’agit des sororités – vivent 24h/24 dans la même maison, partagent le même frigo, la même chambre, la même douche… bref ils se veulent soudés comme les doigts de la main, pour l’éternité. Mais la fraternité est aussi pour eux un véritable tremplin et une promesse d’avenir radieux. Tous les plus grands y sont passés : les Bush, les Rockfeller, les Jefferson… Dans nos hexagonaux esprits, ces « confréries estudiantines » ressemblent à un Projet X permanent, comme nous l’a toujours fait croire la pop culture. Mais en réalité, tout n’y est pas aussi bon enfant que dans le potache American Pie ou dans le encore plus hébétant Road Trip de Todd Phillips. On est loin des blagues lourdingues de post-ados surexcités par cette liberté nouvelle. Au contraire, les fraternités sont aussi faites de « bullies », des clubs où seule la loi du plus fort – et du plus musclé – est reconnue.
La tradition de l’humiliation, du « bizut » à la femme violée
Redouté par les « petits nouveaux » et combattu par les figures d’autorité, le bizutage a toujours trouvé droit de cité dans les fanfaronnades estudiantines. En début d’année universitaire, le « bizut » – une petite chose trop fragile pour qu’elle puisse penser à se rebeller – doit survivre à une série d’épreuves toutes plus humiliantes les unes que les autres, et souvent à tendance scatophile. Tout ça pour trouver grâce aux yeux de ses aînés et prouver qu’il est un parfait mâle alpha, musclé et pas mauviette, capable d’intégrer le club. Ce rituel d’entrée a pour but de « purifier » le futur intégré de son côté féminin, de ses « manières de tapette », de tuer la femme qui est en lui. Car la fraternité veut par tous les moyens rejeter la féminité.
Les frères ne se considèrent que comme des « hommes, des vrais ». Comme le faible, le PD ou le bizut, toute fille qui met les pieds dans leur « repère » est immédiatement réifiée. Une étude universitaire, effectuée par des professeurs des facultés de Maryland et de Pennsylvanie, prouvait que les membres des fraternités avaient une vision plus stéréotypée des genres que la moyenne et qu’ils adhéraient plus à l’idée que les hommes devaient dominer les femmes. Selon Peggy Sanday, universitaire américaine et auteure de Fraternity Gang Rape : Sex, Brotherhood and Privilege on Campus, les filles qui ont la chance de ne pas être considérées comme un vulgaire morceau de viande sont appelées les « petites sœurs ». Elles ont un rôle de « servante » ou, pour les mieux loties, de « confidente ». Les autres ne sont, aux yeux des frères, que des bikinis sur pattes, comme elles sont représentées sur les affiches annonçant des fêtes aux thèmes plus qu’évocateurs : « Victoria’s Secret », « Manoir Playboy », « Secrétaires salopes » ou encore « Proxos et putes ». La règle est simple, celles qui sont trop habillées ne seront même pas invitées. Car la fête – lieu commun dans la culture des fraternités – est l’endroit où le sexe ne doit pas trouver le moindre obstacle.
(Source vanityfair)
Catégories
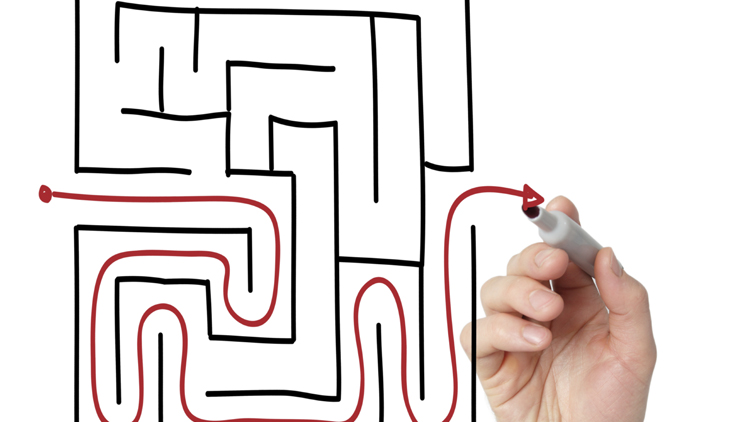
Administration




